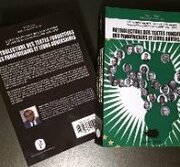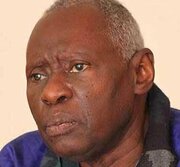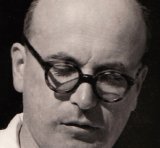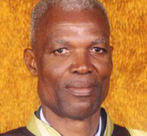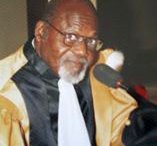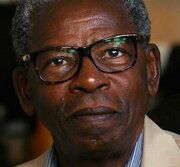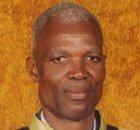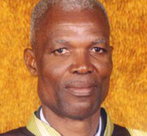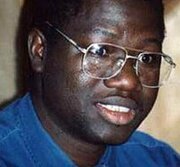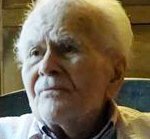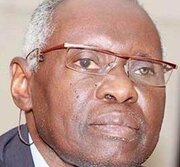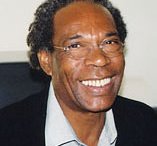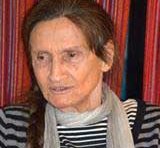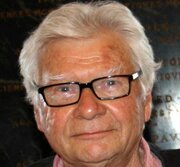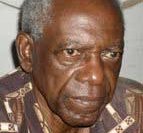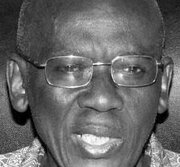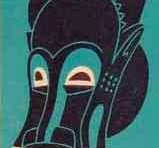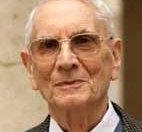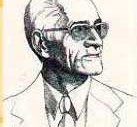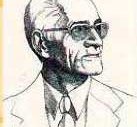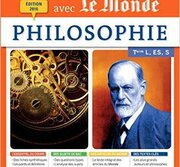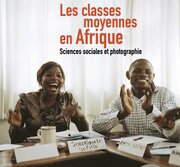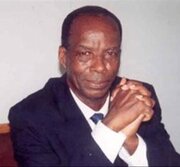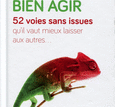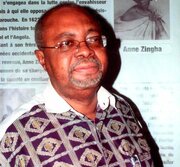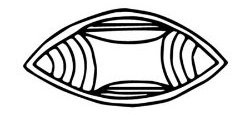LES SYSTÈMES DE NUMÉRATION PARLÉE EN AFRIQUE DE...

LES SYSTÈMES DE NUMÉRATION PARLÉE EN AFRIQUE DE L’OUEST
DU PROF. ABDOULAYE ELIMANE KANE, PHILOSOPHE
ÉDITIONS L’HARMATTAN (COLLECTION ORALITÉS) & PRESSES UNIVERSITAIRES DE DAKAR, 2017
NOTE DE LECTURE DE LILYAN KESTELOOT : RETOUR SUR UN LIVRE ÉVÈNEMENT DE PHILOSOPHIE
Pourquoi ce très savant ouvrage du professeur de philosophie Abdoulaye Elimane Kane se trouve-t-il dans la collection Oralités de l’Harmattan ? - C’est qu’il est le résultat d’une vaste enquête linguistique, d’abord, sur une quarantaine de langues et dialectes du Mali, Sénégal, Gambie, Guinée, Niger, Côte d’Ivoire ; enquête sur les termes désignant les nombres, ainsi que la façon dont on les utilise dans leur usage courant et commercial, mais aussi leur symbolisme dans les rites et coutumes des peuple concernés.
Et le professeur constate que tous ces systèmes numéraux sont élaborés à partir de l’homme, des 5 doigts de la main et des 20 doigts des mains et des pieds de l’homme.
Mais aussi que, en wolof par exemple, le mot nit = homme, et nitt = 20, (ou encore naar fuck, 2x10. Si l’on suit le système décimal importé de l’arabe).
De même dans certains dialectes Joola (Casamance) le chiffre 20 sert aussi de base, et davantage, puisqu’il signifie en même temps homme, roi, et l’Unité.
20 semble toujours la base de numération dans le groupe Mandé où Keme signifie 100 aujourd’hui, mais jadis valait 60 ou 80, soit 3x20 ou 4x20.
Kane développe alors son enquête sur ce Keme, qui signifie ainsi : gros tas, ou encore grande assemblée de gens. Il découvre aussi d’autres propriétés de ces nombres ; le fait qu’ils ont des genres selon leur classe, que la fréquence du redoublement ou de la gemellation est étonnante.
Kane explique longuement la logique de ce système de numération et comment il s’est combiné et transformé avec le système d’importation, pour former les nombres dépassant l’empirisme gestuel primitif.
Poursuivant sa recherche, Kane remarque que certains nombres reviennent souvent dans les coutumes, les rites et autres usages sociaux. Ainsi très souvent le 3 (masculin), le 4 (féminin) et le 7 (unité).
Ces nombres forment un système symbolique qu’on retrouve dans de grandes ethnies de la région comme les Mandé et Hausa.
Le philosophe, frappe par ses similitudes, va poursuivre sa quête par une spéculation sur ces nombres et leur fondement. Il serait normal dès lors qu’il en arrive à explorer l’imaginaire de ces populations, leur terminologie du sacré et leur système de valeurs.
Elimane Kane s’y lance dans sa 2e partie et finit par aboutir à deux grands mythes mis à jour par les chercheurs G. Dieterlen, Youssouf Tata Cissé et Marcel Griaule.
Il remarque que les nombres privilégiés 3, 4, 7 trouvent leur origine dans ces mythes (ou leurs avatars) et plus précisément dans la fonction archétypique accordée à l’homme et à son corps dans ces mythes. Privilégiés seront les nombres avec lesquels les mythes détaillent la création de l’ancêtre primordial issu de l’être supérieur (divin ou indéterminé) pour donner vie au genre humain, double d’abord, ensuite bisexué.
Il faut suivre le philosophe pas à pas dans sa démonstration dont je ne donne ici qu’un trop bref extrait.
On n’en revient pas de son acharnement à ne rien lâcher de la masse d’éléments dont il veut tenir compte. On reste admiratif de sa capacité à rassembler les faits épars récoltés par les chercheurs précédents dans La notion de personne en Afrique Noire (CNRS, 1975), ou chez Dominique Zahan ou Viviana Pâques, Niangoran Bouah ou Alexis Kagame, Girard ou De Heusch. Il a tout lu. Et il en a tiré une synthèse harmonieuse. C’est presque trop beau !!
Cependant on est bien obligé de reconnaître la rigueur soutenue de sa reconstruction.
Il semble qu’aucun travail de cet envergure n’a été encore entrepris sur les systèmes de numération d’Afrique, et qui ne se contente pas de décrire mais d’en trouver la logique, l’origine, et la vision du monde qui les fonde.
Peut-être que seul un philosophe était apte à plonger si profond dans la connaissance africaine ! Ouvrage majeur comme ceux d’Alexis Kagame (La Philosophie Bantu comparée, 1976) ou de Youssouf Tata Cissé (La confrérie des chasseurs Malinké et Bambara. Mythes, rites et récits initiatiques, 1994).
Les perspectives qu’il ouvre aux linguistes, aux historiens, aux sociologues voire à la science politique sont sans limite.