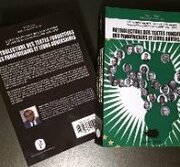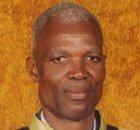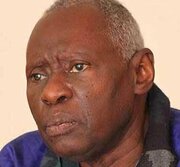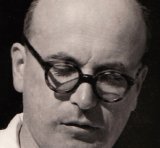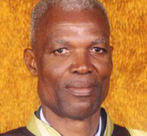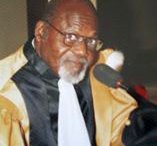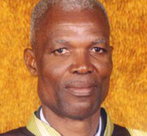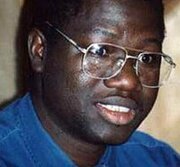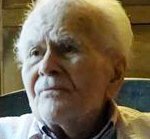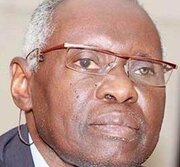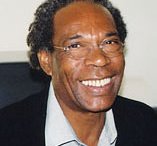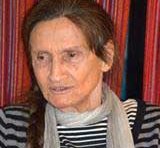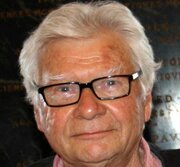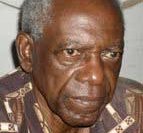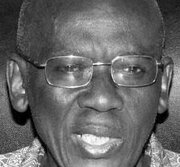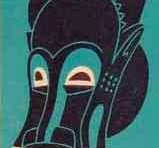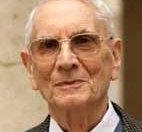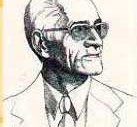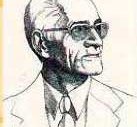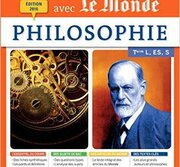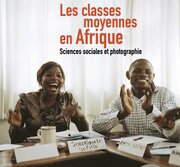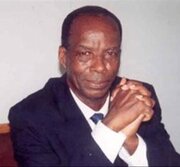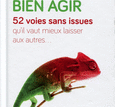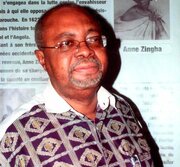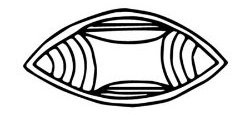ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE – CHINE : CONSIDÉRATIONS GÉOPOLITIQUES – DOCTRINE DE L’AMBIGUÏTÉ STRATÉGIQUE ET TENTATIONS MESSIANIQUES PAR LE PROF. AUGUSTIN F. HOLL & PROF. GAO CHANG, XIAMEN UNIVERSITY

INTRODUCTION
En termes simples et directs, la doctrine de « l’ambiguïté stratégique » mise en œuvre par les États-Unis dans leur politique étrangère chinoise à l’égard de Taïwan, est l’équivalent de « Ne demandez pas, ne dites pas (Don’t Ask, Don’t Tell) ». Elle a été sérieusement ébranlé au cours des dernières années de relations tendues entre les deux pays. Le risque de conflit accidentel est plus élevé que jamais lorsqu’il s’agit de « fierté nationale » mais cela n’empêche pas de tenter de comprendre la situation actuelle d’un point de vue historique, à travers une esquisse d’histoire comparée de la Chine et des États-Unis du XIXe à la fin du XXe siècle.
COTÉ ÉTATS-UNIS
Thomas Jefferson a négocié l’achat de la Louisiane aux Français en 1803 et, ce faisant, a plus que doublé l’étendue territoriale de l’Union. La puissance montante se sentait suffisamment en confiance pour formuler la « Doctrine Monroe » en 1823. Doctrine qui « expulsait » les puissances européennes de l’hémisphère occidental. À partir de 1845, sous le président James K. Polk, le « Manifest Destiny Movement » selon lequel les Euro-Américains étaient destinés à coloniser la terre d’Amérique du Nord d’un océan à l’autre, a alimenté l’expansion territoriale. Déclenchant une multiplicité de guerres : « Les guerres indiennes, la guerre américano-mexicaine (avril 1846-février 1848, le Mexique perd la moitié de son territoire au profit des États-Unis), puis les guerres hispano-américaines (contrôle de Porto-Rico et des Philippines en 1898).
La guerre civile (1861-1865) oppose l’Union aux confédérés. Immédiatement en 1861, Jefferson Davis le nouveau président des États confédérés d’Amérique nomme des diplomates pour nouer des alliances avec des puissances étrangères, notamment la Russie, la Belgique, la France, l’Angleterre et même le Mexique. Les tentatives ont échoué. Les États confédérés ont été vaincus en 1865. Les États-Unis sont entrés dans la Première Guerre mondiale en 1917, faisant pencher la balance des forces en faveur des Alliés, aidant à mettre fin au conflit en 1918 et, en tant que tels, à façonner leur chemin vers le statut de puissance mondiale.
L’attaque de Pearl Harbor par l’armée de l’air japonaise le 7 décembre 1941 précipite l’entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, sur les fronts européen et pacifique, et établit sa position de leader du monde occidental. La guerre froide est déclenchée presque immédiatement, avec la formation de blocs idéologiques et militaires rivaux : l’OTAN (Organisation du traité de l’Atlantique Nord) pour les puissances occidentales, et le Pacte de Varsovie pour l’Europe de l’Est et l’URSS.
En 1947, le président Harry Truman formule la « doctrine du confinement », également connue sous le nom de « Doctrine de Truman », pour limiter l’expansion des idéologies politiques antagoniques aux intérêts occidentaux. La guerre de Corée (25 Juin 1950-27 Juillet 1953) fut la première matérialisation à grande échelle de la nouvelle doctrine. Elle a été suivie de bien d’autres, dont la guerre du Vietnam (1961-1975), le blocus de Cuba (1962), des coups d’État militaires et des contre-coups d’État en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie.
Enfin, plus récemment, la doctrine de la « frappe préventive » formulée sous le président G. W. Bush affirme le droit des États-Unis a mener une action militaire unilatérale contre tout autre État et organisation jugés menaçants pour la « sécurité nationale » Etats-Unienne. Elle a été mise en œuvre lors de la deuxième guerre en Irak, avec des conséquences en cascade que l’on observe aujourd’hui.
Il y a clairement une tentation messianique dans la diplomatie américaine actuelle, qui prétend mettre en œuvre la liberté de navigation, exercer une surveillance vigilante sur les violations des droits de l’homme, sanctionner ceux qui ne s’y conforment pas et contrôler le monde avec sa puissance militaire et financière.
COTÉ CHINE
Les puissances européennes ont afflué en Chine au 19ème siècle. La dynastie Qing alors au pouvoir était faible. Pas à pas, les nations européennes ont profité de la situation interne pour créer des enclaves « extra-territoriales » où les lois chinoises ne s’appliquaient pas.
Les deux épisodes "de la Guerre de l’Opium" ont été lancés en 1839 par les Britanniques et rejoints plus tard par les troupes françaises. La Chine tentait d’interdire l’importation de l’opium qui causait une grave dépendance et provoquait de graves problèmes sociaux dans ses villes et campagnes. Cette politique douanière raisonnable a été contrée par des canons – Politique de la Canonnière - pour soutenir le trafic de drogue. Le pays a été contraint d’ouvrir ses villes et ses marchés aux marchands européens d’opium.
De 1860 à 1900, les puissances étrangères ont sculpté leurs « micro-États” -Légations - indépendants dans différentes parties de la Chine côtière et intérieure : les Britanniques dans la vallée du Yangtze de Shanghai à Chongqing, Japonais au Fujian et à Taïwan, Allemands au Shandong et Français au Guangxi et Yunnan. Sans surprise, dans la mémoire sociale chinoise, tout le 19e siècle est surnommé « le siècle de la honte »
Les années de la République (1912-1949) ont été marquées par des conflits entre factions rivales et la sédition des chefs de guerre locaux. Le Parti communiste chinois a été formé en 1921 à Shanghai, dans l’est de la Chine. L’armée japonaise envahit la Mandchourie en 1931 et créa l’État fantoche du Mandchoukouo, non reconnu internationalement. Le Kuomintang [KMT] et le Parti communiste chinois [PCC] ont créé un Front uni contre l’agression japonaise. Cependant, comme l’a documenté le général Joseph Stilwell, chef d’état-major de Chiang Kai-shek et commandant des forces américaines en Chine/Birmanie (1942-1944), le chef du Kuomintang était plus intéressé par la lutte contre les communistes chinois que celle contre l’armée d’invasion japonaise. La guerre de résistance contre l’agression japonaise a duré de 1937 à 1945, les États-Unis soutenant Tchang Kaï-chek et le régime nationaliste. Le PCC et l’Armée rouge, sa branche armée, ont acquis leur popularité et légitimité grâce à la guerre de résistance. Les troupes du KMT ont commencé à perdre du terrain après la défaite de l’armée japonaise, déplaçant successivement leurs quartiers généraux de Nanjing, a Guangzhou, puis Chongqing, Chengdu. Chiang Kai-shek et le reste de l’armée et des responsables du KMT ont fui à Taïwan en 1949 après la victoire de l’Armée rouge, initiant une sécession de facto de la République populaire de Chine (RPC) nouvellement proclamée. Les faits sont têtus. Taïwan est province sécessionniste de la RPC.
La Chine a également té impliquée dans des conflits localisés successifs avec ses voisins, d’abord Soviétique, à commencer par le 1er conflit sino-soviétique en 1929 ; en fait un conflit armé mineur entre un chef de guerre local et l’armée soviétique dans le nord-est de la Mandchourie, puis le conflit militaire de 7 mois sur l’île de Zhenbao (mars-septembre 1969) sur des revendications territoriales, et la « scission sino-soviétique » alimentée par des divergences doctrinales sur la mise en œuvre du marxisme, et aboutissant à l’annulation des accords de coopération économique, scientifique et militaire.
En 1950, la République populaire de Chine nouvellement formée a pris le contrôle du Tibet. La même année, des volontaires de l’Armée populaire de libération participent à la guerre de Corée du 3 novembre 1950 au 24 janvier 1951, lors d’une intervention massive qui change le cours de la guerre. Une guerre sino-indienne a eu lieu dans les montagnes du Karkoram en 1962. Et enfin il y a eu une guerre sino-vietnamienne qui a duré du 17 février au 16 mars 1979.
Jusqu’au vote de la résolution 2758 de l’Assemblée générale des Nations Unies, adoptée le 25 octobre 1971 reconnaissant la République populaire de Chine comme seul représentant de la Chine, et la visite à Pékin de Richard Nixon, président des États-Unis d’Amérique en février Le 21 décembre 1972, le régime Kuomintang de Taipeh avait le siège de la Chine à l’ONU et ce pendant plus de 20 ans.
CONCLUSION
La politique chinoise actuelle des États-Unis d’Amérique à l’égard de Taïwan ne découle pas d’une position de neutralité initiale. La politique est dictée par la « doctrine du confinement » et soutenant un allié « permanent ».
C’est une évidence mais il faut le souligner : les orientations stratégiques des États sont façonnées par leur histoire. L’histoire n’a ni but ni fin. Il est donc évident de s’attendre à des différences significatives entre des États aux histoires divergentes, en l’occurrence les États-Unis d’Amérique et la République populaire de Chine.
Le premier est en ascension affirmée vers le statut de puissance mondiale depuis le début du 19ème siècle. Le second a été la proie des puissances européennes pendant le 19ème siècle. Ces situations divergentes ont généré des mentalités très différentes dans les cercles gouvernementaux. La question n’est clairement pas celle de la moralité, le bien contre le mal. « Le pouvoir de l’État est amoral » et formuler la politique étrangère en termes moraux est une auto-illusion.
Une comparaison est particulièrement éclairante si l’on regarde la gestion des soutiens internationaux en situation de crise : la guerre civile aux États-Unis (1861-1865), et la guerre civile en Chine (1945-1949). En 1861, le président des États confédérés d’Amérique (CSA), pleinement convaincu que ce sera une opération facile, a envoyé des diplomates aux grandes puissances européennes [Russie, Belgique, Angleterre et France] et même le Mexique « spolié », pour demander leur soutien dans la guerre contre l’Union. Le mouvement a échoué. Aucun de ces pouvoirs n’a voulu créer le précédent de soutenir un État sécessionniste. Il n’y a eu aucune ingérence étrangère dans la guerre civile américaine qui est restée une affaire intérieure.
La situation est exactement l’inverse du de la Question de Taïwan. Les États-Unis, soutenant les Britanniques et pour différentes autres raisons, étaient profondément impliqués dans les affaires intérieures de la Chine. Joseph Stilwell, un général États-Unien était chef d’état-major de Chiang Kai-shek (1942-1945). L’establishment de la politique étrangère États-Unienne a soutenu le régime du Guomintang dans une mise en œuvre standard de la « doctrine Truman ». L’alliance stratégique entre les États-Unis, le régime de Taipeh et Taiwan aujourd’hui n’avait au départ rien à voir avec la démocratie, les droits de l’homme et la liberté religieuse. Elle est ancrée sur l’endiguement du communisme. L’extraordinaire développement économique de la Chine sous le Parti communiste chinois a exacerbé la tension. Les États-Unis ne sont clairement pas un tier-parti neutre, s’inquiétant de la liberté de navigation en Mer de Chine méridionale. Taïwan a été coupé du reste de la Chine par le Kuomintang vaincu en 1949. La doctrine de l’ambiguïté stratégique est donc un simple déguisement rhétorique basé sur des inclinations messianiques.