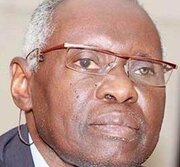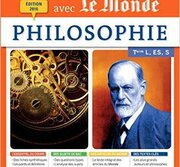DE NEGRO A AFRICAIN AMERICAIN : LES FONDS SONORES DE L’EVOLUTION IDENTITAIRE AFRICAINE AMERICAINE PAR SHEILA S. WALKER, ANTHROPOLOGUE

DE NEGRO A AFRICAIN AMERICAIN :
LES FONDS SONORES DE L’EVOLUTION IDENTITAIRE AFRICAINE AMERICAINE PAR SHEILA S. WALKER, ANTHROPOLOGUE
La musique des années cinquante à soixante-dix a joué un rôle très important dans l’évolution identitaire des africains américains. La musique de danse des orchestres cubains, le calypso de Harry Belafonte, la musique nigériane de Babatunde Olatunji et sud-africaine de Miriam Makeba, ainsi que le soul affirmatif de James Brown, ont aidé les africains américains à développer et la fierté d’être noir et une identification avec le monde pan-africain.
Une musique à part d’une communauté à part
Dans la société ségréguée des Etats-Unis, par loi dans le sud, par coutume dans le nord, nous, africains américains, parmi d’autres aspects de notre particularité culturelle, avons toujours eu notre propre musique, différente de celle de la population blanche.
La musique si dynamique de nos églises, ségréguées jusqu’à aujourd’hui, est tout à fait différente - les polyrythmes et la polyphonie d’origine africaine aidant - de celle des églises blanches. Le monde entier apprécie nos Negro Spirituals, et beaucoup de nos meilleurs chanteurs, telle qu’Aretha Franklin, chantaient d’abord dans les chorales d’église et n’ont jamais cessé de chanter cette musique. Aretha a même enregistré un album, Amazing Grace, de musique sacré africaine américaine.
La musique classique des blancs états-uniens est la musique des compositeurs européens. La nôtre, le jazz, est la seule musique classique crée aux Etats-Unis.
Notre musique populaire, en plus d’influencer le monde entier, tout comme le jazz, était copiée et appropriée par des blancs. Elvis Presley était le chanteur le mieux connu pour cette pratique, qui s’appelait “covering” (couverture). Jusqu’à la fin des années cinquante, des artistes blancs s’enrichissaient en chantant les morceaux des chanteurs africains américains sans en reconnaître leurs origines, pendant que ceux-ci vivaient dans une obscurité et une misère relative. (You Ain’t Nothin’ But a) “Hound Dog,” grande tube de Presley en 1955, avait été enregistré en 1952 par l’africaine américaine Big Mama Willie Mae Thornton.
Depuis le début du 20ième siècle nous avons même notre propre “hymne national,” caractérisé comme tel par le peuple africain américain en expression de notre sentiment d’être une communauté à part à l’intérieur de la nation. Le Negro National Anthem, “Lift Every Voice and Sing,” a été écrit comme poème en 1899 par James Weldon Johnson, auteur très connu de la Renaissance d’Harlem. Son frère John Rosemond Johnson en a composé la musique en 1900. La chanson a été chanté pour la première fois par une chorale de cinq cents écoliers africains américains dans la ville de Jacksonville en Floride. A la différence de l’hymne national du pays, le “Star Spangled Banner,” qui parle de l’éclatement de bombes, le nôtre parle des luttes, de la foi, de l’espoir, et de la fidélité à la nation des africains américains.
On l’entend aujourd’hui surtout dans des écoles, des églises, et des presque cent universités africaines américaines du sud du pays, ainsi que dans des évènements culturels des organisations africaines américaines partout dans le pays. Quand la National Association for the Advancement of Colored People, NAACP, (l’Association Nationale pour le Progrès des Gens de Couleur) se formait pendant les année 1920, la chanson est devenue leur thème musical, ce qui leur attirait un publique important. Beaucoup de chanteurs connus, tel que Ray Charles, l’ont chanté.
Notre hymne a aussi eu du succès au niveau international quand les chorales africaines américaines, telle que les Fisk College Jubilee Singers, l’ont chanté lors de leurs tournées dans le monde. “Lift Every Voice and Sing” a même été chanté en Angola en 1930 à Galangue en langue Umbundu du peuple Ovimbundu pour commémorer les cinquante ans de la présence d’un groupe de missionnaires étrangers.
Bien plus tard, pendant les années 1990, quand nous chantions “Nkozi Sikelele” (Que Dieu Bénisse l’Afrique) en solidarité avec la lutte anti-apartheid du African National Congress (Congrès National Africain) d’Afrique du Sud, parfois on chantait les deux hymnes l’un après l’autre pour affirmer le sentiment commun.
Plus récemment, le 20 janvier, 2009, à la cérémonie historique de l’inauguration du Président Barack Obama, le Révérend Joseph Lowery en a recité le troisième verset pour commencer sa bénédiction de l’évènement qui était la réalisation de cet espoir.
Lift every voice and sing, till earth and Heaven ring,
Ring with the harmonies of liberty ;
Let our rejoicing rise, high as the listening skies,
Let it resound loud as the rolling sea.
Sing a song full of the faith that the dark past has taught us,
Sing a song full of the hope that the present has brought us ;
Facing the rising sun of our new day begun,
Let us march on till victory is won.
Stony the road we trod, bitter the chastening rod,
Felt in the days when hope unborn, had died ;
Yet with a steady beat, have not our weary feet,
Come to the place for which our fathers sighed ?
We have come, over a way that with tears has been watered,
We have come, treading our path through the blood of the slaughtered ;
Out from the gloomy past, till now we stand at last
Where the white gleam of our bright star is cast.
God of our weary years, God of our silent tears,
Thou Who hast brought, us thus far on, the way ;
Thou Who hast by Thy might, led us into the light,
Keep us forever in the path, we pray.
Lest our feet, stray from the places, our God, where we met Thee.
Lest our hearts, drunk with the wine of the world, we forget Thee.
Shadowed beneath Thy hand, may we forever stand,
True to our God, true to our native land.
Nos corps comprenaient même si nos têtes ne comprenaient pas
Un début du processus d’élargissement de notre identité au delà des frontières des Etats-Unis est venu sans que l’on ne sache qu’il se passait quoi que ce soit de différent, même de subversif. Qu’il se passait quelque chose qui — dans une époque étroitement assimilationiste, pendant laquelle nous voulions être 100% américains, bien que noir — promettait d’élargir le monde de notre identité. Ce debut inconscient d’une nouvelle conscience a commencé pour un groupe de jeunes de New Jersey, duquel je faisais partie, dans un bal. C’était le début des années soixante qui seraient si transformatrices pour la société états-unienne et mondiale. L’orchestre jouait notre musique africaine américaine et on dansant aux rythmes familiers.
Subitement le rythme a changé. Du familier, il est devenu du jamais entendu. Que faire ? Regarder ceux qui avaient l’air de savoir que faire, bien sûr. Ayant le sens du rythme, on n’était pas trop désaxé. Un peu perplexe, mais pas pour longtemps. On a vite compris en suivant des yeux et des pieds les pas des autres.
“Ca s’appelle comment ?” on a demandé à ceux qui avaient l’air d’en savoir plus que nous. “Pachanga,” disaient certains. “Charanga,” disaient d’autres. Des terminologies inhabituelles pour nos oreilles anglophones. Des rythmes et des mouvements du corps différents, mais pas trop. Qui correspondaient suffisamment à notre répertoire gestuel pour qu’on s’adapte sans comprendre pourquoi c’était si semblable tout en étant différent.
Une espèce de cha-cha-cha et de mambo, dansés de façon assez mécanique, faisaient déjà partie des éléments musicaux de la culture générale états-unienne, du moins dans la région new-yorkaise. On les voyait à la télé.
Mais avec la pachanga et la charanga nous avons aussi appris quelque chose de plus swinguant qui s’appelait aussi mambo et cha-cha-cha. Pour nous de New Jersey, en face de New York, ces nouveautés devaient venir de New York, source de tant de merveilles. Mais au fait cette nouveauté nous venait de plus loin sur le plan géographique, et de beaucoup plus loin sur le plan historique. Mais on ne le savait pas encore.
Comme on ne connaissait ni la géographie de cette musique, ni notre grande histoire africaine et diasporique, on n’avait aucune base pour comprendre la signification profonde du moment. Le rythme plus syncopé secouait plus que nos corps. Il secouait aussi notre identité limitée d’états-uniens et insinuait qu’autre chose s’y infiltrait à partir d’autres terres.
Tout était en espagnol. De Cuba ? On ne comprenait pas les paroles. Et on ne s’en préoccupait pas. L’essentiel était de savoir comment la danser.
Quelque part on comprenait que malgré la terminologie, il y avait une différence fondamentale entre cette musique qui nous faisait danser, et celle jouée et dansée à la télévision par des blancs. Mais comme on ne connaissait pas encore l’existence d’une diaspora africaine à travers les Amériques, on ne savait pas que partout dans l’hémisphère il y avait d’autres afrodescendants qui jouaient, comme nous, une musique différente de celle de leurs compatriotes d’origine européenne, et qui avait ses racines en Afrique. Cétait la raison pour laquelle cette musique étrangère ne nous était pas tellement étrangère.
De nouvelles découvertes sonores - Caraïbéenes et Africaines
A la même époque, on a entendu la voix de Harry Belafonte qui chantait “Day-O,” sa chanson la plus connue, ainsi que “Jamaica Fairwell” et “Matilda (She Take Me Money and Run Venezuela).” Ces chansons traditionnelles caraïbéenes faisaient allusion à des lieux dont on avait entendu parlé et à des situations qu’on pouvait comprendre.
“Day-O — The Banana Boat Song” (La chanson du bateau bananier), avec son refrain, “Daylight come an me wan’ go home” (le jour se lève et je veux rentrer) parlait des travailleurs caraïbéens qui chargeaient les bateaux d’exportation de bananes. Après avoir travaillé dur pendant toute la nuit, ils voulaient recevoir leur paie et rentrer chez eux. De notre coté, on avait des pères qui travaillaient dur au Port de Newark, qui déchargeaient, entre autre, des bananes qui venaient des iles caraïbéenes.
On comprenais que l’anglais des chansons était différent de l’anglais standard des Etats-Unis, mais pas trop différent de notre façon africaine américaine de parler cette langue. L’album Calypso, 1956, de Belafonte, était le premier 33 tours dont plus d’un million d’exemplaires se sont vendus aux Etats-Unis.
Puis, comme reflet d’une nouvelle dynamique politique, une nouvelle géographie musicale s’est ajoutée à la bande sonore de l’évolution de la conscience identitaire africaine américaine. Avec les indépendances africaines, à commencer par le Ghana en 1957 et la Guinée en 1958, suivis par d’autres pays à partir de 1960, la présence de diplomates africains dans les missions des Nations Unies à New York et les ambassades à Washington, ainsi que des étudiants africains dans des universités à travers le pays, nous a permis de découvrir des représentants de populations semblables à nous, mais qu’on n’avait connu qu’à travers des images peu obligeantes, style Tarzan, des média. Mais ces diplomates et étudiants africains qu’on rencontrait en chair et os n’avaient rien en commun avec ces images racistes.
Avec cette nouvelle présence humaine, la musique africaine s’est ajoutée à la musique caraïbéenes comme fonds sonore pour l’évolution de notre compréhension d’une géographie humaine et historique africaine et afrodescendante. En 1960 l’album Drums of Passion/Jin-Go-Lo-Ba, du percussionniste nigérian Babatunde Olatunji, a explosé sur la scène musicale et a eu un grand succès en vendant plus de cinq millions de disques. Olatunji, qui a étudié à Morehouse College, une université africaine américaine, a participé à des manifestations de la lutte pour les droits civiques des africains américains et a joué avec beaucoup des meilleurs musiciens de jazz africains américains.
Miriam Makeba, avec l’aide de Harry Belafonte, est venue renforcer cette présence musicale africaine aux Etats-Unis. Elle a apparu à la télévision en novembre 1959. Sa première tube, “The Click Song” (La Chanson à Cliques) nous a intrigué par le son de sa langue Xhosa. La chanson faisait allusion à une scarabée qui symbolise pour le peuple Xhosa la pluie bénéfique pour leurs champs et par extension à la chance et l’espoir d’un meilleur avenir (Makeba 1987 : 86). Nous pouvions facilement nous identifier à sa lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud tellement semblable à notre lutte contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis. Sa chanson “Pata-Pata,” qui l’avais déja rendu connue en Afrique du Sud en 1956, n’est sorti aux Etats-Unis qu’en 1967. “Pata-Pata” est devenu une musique incontournable dans nos fêtes d’étudiants noirs à l’université qui rassemblaient africains américains, caraïbéenes, et africains.

La fierté d’être noir et d’origine africaine
Pendant les années cinquante, les africains américains luttions pour nous intégrer à la société blanche, pour nous assimiler à ses valeurs, ses comportements, et son style, à fin de pouvoir bénéficier des droits de citoyenneté que la Constitution du pays garantissait à tous, mais desquels nous étions exclus. Alors on essayait de ne pas se distinguer sur la plan culturel, surtout que le système éducatif et les média avaient fait de leur mieux pour nous faire croire que nous n’avions pas de culture et que tout ce qui était blanc était supérieur. On s’appelait “colored” (gens de couleur) ou “Negro,” mais pas noir. Appeler quelqu’un de noir était une insulte.
Dans notre désir d’être des citoyens à plein titre des Etats-Unis, on ne voulait surtout pas s’identifier à l’Afrique, une Afrique qui était toujours représentée comme sauvage. A part les écrits de nos quelques grands intellectuels, tels que W.E.B. DuBois et Carter G. Woodson, on n’avait pas de contrepoids pour nous donner une base pour penser autrement et pour voir l’Afrique et les africains d’une façon qui nous donnerait envie d’y voir notre heritage. C’était mieux de ne pas avoir d’héritage culturel que d’en avoir un qui portait préjudice.
Mais, avec les réussites de la lutte pour les droits civiques, on a commencé à entrer dans les meilleurs universités en nombre suffisant pour représenter une toute petite masse critique qui pouvait créer des groupes d’études dans lesquels on apprenait des vérités sur l’Afrique et sur notre propre histoire qu’on ne nous enseignait pas dans nos cours eurocentriques. En plus, il y avait des étudiants africains si semblables à nous-mêmes, contrairement à ce que d’autres gens voulaient qu’on croie.
Cette confluence de circonstances nous a stimulé à commencer à faire de la recherche sur notre vraie histoire aux Etats-Unis et aux Amériques. On apprenait que contrairement à ce que nos professeurs essayaient de nous enseigner, on avait de la culture d’origine africaine qui était à la base de notre spécificité culturelle aux Etats-Unis. Et on apprenait plus sur la diaspora africaine à travers le reste des Amériques, ce qui expliquait les similitudes musicales qu’on avait compris sans savoir pourquoi. On apprenait aussi une histoire africaine pas du tout sauvage, une histoire dans laquelle l‘Afrique a été plutôt traitée de façon sauvage par l’Europe.
Comme résultat et de notre recherche et de nos contactes avec des africains, on a commencé à ne plus vouloir s’identifier aux blancs, surtout que leur rôle historique par rapport à nous africains américains et africains s’est avéré moins supérieur que condamnable. Au contraire, on a décidé de se redéfinir comme noir par rapport aux blancs qu’on ne voulait plus imiter, et comme afro-américain et plus tard africain américain pour réclamer cet héritage qu’on était en train d’apprendre nous-mêmes. On s’appropriait la terminologie d’une identité qui affirmait et notre noirceur et notre africanité.
La chanson qui le mieux représente cette nouvelle conscience, qu’on pouvait caractériser comme une espèce de nouvel hymne national d’une nouvelle identité africaine américaine était “Say It Loud – I’m Black and I’m Proud,” (Dis le fort - Je suis noir et fière de l’être) du Godfather of Soul (le Parrain de la musique Soul), James Brown. La chanson est sortie en 1968, peu après et comme réaction à l’assassinat du Dr. Martin Luther King Jr., un assassinat qui a provoqué ce que la presse appelait des “émeutes,” que nous appelions des “rebellions urbaines,” à Chicago.
Brown a enregistré la chanson avec une chorale d’une trentaine de jeunes des communautés africaines américaines de Los Angeles telles que Watts, lieu de la première rebellion urbaine en 1965. On constate une similitude, plus de cinquante ans plus tard, avec “Lift Every Voice and Sing” dans le fait d’inclure des jeunes. Le style était celui de l’appel et la réponse caractéristique de la musique africaine américaine qui n’a pas oublié ses racines africaines. Brown donnait la commande, “Say it loud” et les jeunes répondaient, “I’m Black and I’m proud.”
Look a’here, some people say we got a lot of malice
Some say it’s a lotta nerve
I say we won’t quit moving
Til we get what we deserve
. . .
Brother, we can’t quit until we get our share
Say it loud,
I’m black and I’m proud
Say it loud,
I’m black and I’m proud, one more time
Say it loud,
I’m black and I’m proud, huh
I’ve worked on jobs with my feet and my hands
But all the work I did was for the other man
And now we demand a chance
To do things for ourselves
we tired of beating our heads against the wall
And working for someone else
Say it loud,
I’m black and I’m proud
(Repeat)
. . .
We rather die on our feet,
Than keep living on our knees
Say it louder,
I’m black and I’m proud
(Repeat)
Il y a des gens qui disent que nous sommes méchants
Il y en a qui disent que nous avons du toupé,
Moi je dis qu’on ne s’arretera pas d’avancer
jusqu’à ce qu’on obtient ce que nous méritons.
. . .
Frère nous ne pouvons pas nous arrêter
jusquà ce que on obtient notre part.
Dis le fort.
Je suis noir et fière de l’être.
bis . . .
J’ai eu beaucoup de boulots où j’ai fait des mains et des pieds.
Mais tout mon travail était au bénéfice d’autres gens.
Maintenant nous exigeons la possibilité
de nous occuper de nous-mêmes.
Dis le fort.
Je suis noir et fière de l’être.
bis . . .
Nous préférons mourir debout
que vivre à genou
Dis le fort.
Je suis noir et fière de l’être.
bis . . .
La chanson a eu un succès immédiate, et dans les concerts le publique africain américain repondait avec enthousiasme. Brown a perdu pendant ce temps une bonne partie de sa publique blanche qui, comme la chanson avait prédit, trouvait “raciste” de telles expressions de fierté et de désir de participer pleinement dans la société états-unienne de la part des africains américains. Dans nos fêtes on criait “Say it loud” et répondait “I’m Black and I’m proud,” affirmant une nouvelle identité non plus limitée aux frontières des Etats-Unis, tout en dansant.
BIBLIOGRAPHIE
- Belafonte, Harry. My Song : A Memoir. New York : Alfred A. Knopf, 2011.
- Brown, James, with Bruce Tucker. James Brown : The Godfather of Soul. New York : Macmillan Publishing Company, 1986.
- Makeba, Miriam. Makeba : My Story. New York : New American Library, 1987.
- Olatunji, Babatunde. The Beat Of My Drum : An Autobiography. Philadelphia : Temple University Press, 2005.
- Smith, R.J. The One : The Life and Music of James Brown. New York : Gotham Books, 2012.