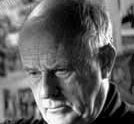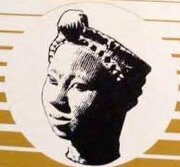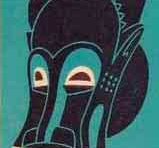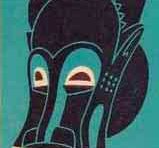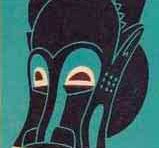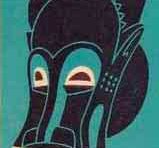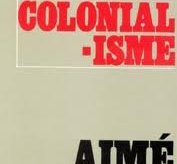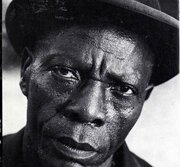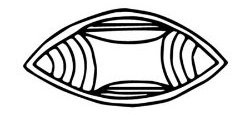DIVINITÉ ET EXPÉRIENCE, LA RELIGION DES DINKA » (SOUDAN) DE GODFREY LIENHARDT

DIVINITÉ ET EXPÉRIENCE, LA RELIGION DES DINKA (SOUDAN) DE GODFREY LIENHARDT. DIVINITY AND EXPERIENCE. THE RELIGION OF THE DINKA,
OXFORD UNIVERSITY PRESS, LONDRES, 1961
NOTE DE FRANÇOIS-ANDRÉ ISAMBERT
Les Dinka comptent quelque 900.000 (en 1961) personnes réparties, dans le Soudan méridional, autour du bassin du Nil. En étudiant leur religion, l’auteur fait plus qu’œuvre d’ethnographe : c’est une réflexion les rapports entre ces hommes et le monde du Divin qu’il nous propose, réflexion prétendre sa validité au-delà du peuple étudié, mais dont on sent chaque pas qu’elle pourrait s’appliquer plus largement.
A travers l’analyse du mode de vie, des représentations, des mythes et du rituel des Dinka, deux notions essentielles se retrouvent en effet : d’une part la dualité fondamentale de humain et du divin, d’autre part le fait, pour l’homme, de subir (passio) les puissances surhumaines qui régissent son sort. Ainsi se trouvent tracés les cadres d’une théorie de l’expérience du divin qui évoque irrésistiblement certaines des meilleurs pages de l’Expérience mystique de Lévy-Bruhl, mais avec, apparemment, une nuance phénoménologique plus accusée. Ce qui constitue la Divinité chez les Dinka est en somme une certaine manière de subir l’expérience, de pâtir : il serait possible de dire que les Puissances Dinka sont les images des passiones humaines, vues comme les sources actives de ces passiones (p.151). En sorte que telle divinité qui semble d’abord personnifier purement et simplement une force de la nature — en l’occurence la pluie — est, en fait, beaucoup plus précisément une incarnation de l’expérience humaine de cette pluie, de tout ce qu’elle apporte à l’homme et de tout ce que l’homme peut en attendre.

Mais cette passivité et cette dualité fondamentales ne sont pas sans contrepoids. Il y a d’abord le rôle médiateur de clans privilégiés, dits « maîtres du harpon », dont le rôle est ambivalent, à la fois utiles de par leurs fonctions cultuelles et menaçants de par leur monopole. Il y a aussi les manières de retourner la situation par invocation collective et action symbolique. La première constitue une véritable prise sur le Divin, car l’expérience collective possède une vérité qui assure la réalité du contrat et rend la parole efficace.
L’action symbolique s’effectue en particulier dans le sacrifice du bétail, où le processus de « victimisation » paraît destiné faire entrer la Puissance dans l’animal sacrifié et à la vaincre, en même temps qu’on lui témoigne des marques de respect. Dans l’un et dans l’autre cas, l’ambivalence des attitudes à l’égard du divin paraît entière, cependant qu’une autre dualité ́se révèle celle de l’individu et de la collectivité. Mais alors que chez Durkheim le divin est une hypostase de la société, le rapport est ici plus complexe, le collectif restant bien du domaine de l’humain, mais étant capable d’équilibrer, sinon de renverser le rapport de forces entre le divin et l’humain.