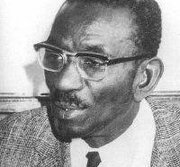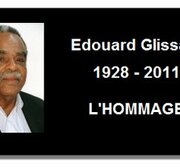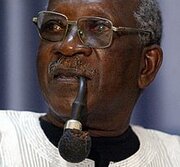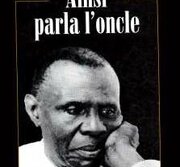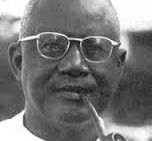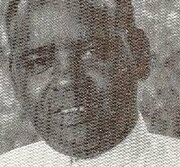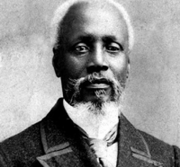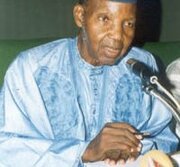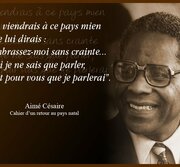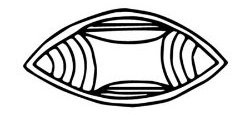Engelbert Mveng

Mveng Engelbert (1930-1995),
fut premier jésuite camerounais protagoniste emblématique de la première génération de théologiens africains. Poète, philosophe, théologien de l’inculturation, anthropologue, peintre, écrivain, historien enseignant d’histoire à l’Université de Yaoundé de 1965 à 1995.
E. Mveng était né le 9 mai 1930 à Enam-Nkal, paroisse de Miniaba, de Jean Amougou et Barbe Ntolo. Études secondaires au Petit Séminaire de Yaoundé. Après une année au Grand Séminaire de Yaoundé, en 1951, il entra au noviciat de la Compagnie de Jésus à Djuma (Rep. Dém. du Congo). Le 22.09.1953 il fit sa première profession. Études philosophiques à Eigenhoven (Belgique) et théologiques à Lyon (France). Ordonné prêtre en 1963.
Engagé dans le mouvement culturel de la Négritude et filleul d’Alioun Diop, E. Mveng fut un promoteur convaincu de la nécessité et de la possibilité d’un christianisme inculturé. « L’inculturation est probablement le problème-clé ainsi que le plus grand défi de la théologie africaine…".
« Le contexte socio-historique du processus de la conversion de l’Afrique à l’Eglise de Jésus Christ a connu maintes hypocrisies et soulève bien des questions qu’il est inutile d’éluder ».
« La spiritualité de la libération a ses racines en Égypte pharaonique. C’est en Égypte qu’est née la plus ancienne et la seule religion dont le dogme enseigne la victoire de la vie sur la mort. La morale pharaonique annonce le Décalogue et la Bonne Nouvelle des Béatitudes. Isis et Osiris ont enseigné la vérité sur l’homme, sur le monde, et sur l’au-delà. Ils ont enseigné à l’homme l’art de vaincre la mort, la praxis de la libération. C’est dire que la réflexion théologique sur la libération trouve ses fondements historiques et épistémologiques en Égypte pharaonique. La spiritualité de la libération qu’apporte l’évangile conduit aux Béatitudes. La spiritualité des Béatitudes célèbre le triomphe de la vie sur la mort, de l’amour sur la haine, de liberté sur la servitude. La spiritualité des Béatitudes invite au discernement, le chrétien devrait être un éternel contestataire. Cela lui donne d’être un éternel contestataire et d’être un prophète ».
E. Mveng a été parmi les pionniers de la théologie africaine et l’un des auteurs du célèbre texte : Personnalité africaine et catholicisme, une réflexion originale africaine élaborée à l’occasion du Concile Vatican II. Il a aussi été parmi les promoteurs de l’exigence d’un concile africain, proposition qui a débouché finalement sur le premier Synode africain de 1994.
L’histoire chez Engelbert Mveng se décline comme discours de l’homme africain qui communique à ses semblables ce qu’il a reçu, et il le transmet ; l’histoire a une double orientation chez Mveng ; elle est à la fois, histoire d’Afrique Noire en général et du Cameroun en particulier ; à cet effet, Mveng cherche les sources dans un travail colossal : Les sources grecques de l’histoire Africaine, depuis Homère jusqu’à Strabon. Il est l’auteur du premier ouvrage d’histoire de son pays. Mveng est aussi historien de l’Église du Cameroun dont il cherche les sources.
L’atelier d’art religieux fondé par E. Mveng à Yaoundé se proposait de concrétiser l’inculturation et de reproduire des modèles d’ornements liturgiques puisant leur inspiration dans l’art africain. Parmi les œuvres artistiques du P. Mveng, il y a entre autres : les mosaïques de Notre Dame d’Afrique (basilique de Nazareth, Israël) et de N. D. des Victoires, cathédrale de Yaoundé ; les tableaux de la chapelle du Collège Hekima (Nairobi), du collège Libermann de Douala (Cameroun).
Pendant plusieurs années il fut le secrétaire de l’Association œcuménique des Théologiens Africains (EATWOT). En présentant le livre des Actes de la Rencontre Panafricaine du Caire, il écrivait : « L’œcuménisme en Afrique doit aller au-delà de l’inventaire de nos traditions respectives, de la simple affirmation de nos vieilles identités. Nous sommes invités aujourd’hui à nous engager pour refaire l’unité visible de l’Eglise du Christ. Les Eglises d’Afrique, très dynamiques et efficientes dans les premiers siècles de la chrétienté, peuvent fournir encore une contribution irremplaçable dans l’édification de l’unité visible du Corps du Christ". A propos du rôle libérateur de la théologie, il souligna la force libératrice des Béatitudes. "La libération latino-américaine veut se libérer de l’impérialisme, du capitalisme du Nord… en Afrique la théologie de la libération pose la question de Dieu".
En 1977 il fonda une association religieuse, la « Famille des Béatitudes », qui se heurta à plusieurs difficultés. Elle devait vivre le Message des Béatitudes, qui "proclament que les puissances et les agents de la mort qui nous assaillent tous les jours, la pauvreté, la faim, la soif, l’injustice, l’humiliation, le péché, la haine, la violence seront surmontés, vaincus et dépassés par l’amour". "Une des choses qui me font pleurer, je le dis tout haut, c’est que l’Afrique sacrifie chaque jour les meilleurs de ses enfants sous prétexte qu’un tel a dit qu’il n’est pas d’accord avec tel chef d’État. Je ne peux pas comprendre qu’on condamne un homme à mort pour ses opinions".
Le matin du 23 avril 1995 E. Mveng fut trouvé mort. Etranglé dans sa maison à la périphérie de Yaoundé dans des circonstances qui n’ont jamais été élucidées. Couché dans son lit face au plafond, une profonde blessure à la tête. Un meurtre inexplicable, puisque rien n’avait été emporté de sa chambre.
"Des voix coururent que l’assassinat du P. Mveng a été l’œuvre de "groupes mystiques’, pratiquant des cultes exotériques et se disputant le contrôle de l’apparat de l’Etat. Ils procèdent à l’élimination des intellectuels, des gens qui dérangent".
La figure de Mveng, de nombreuses années après sa mort tragique, continue de hanter la conscience des intellectuels et plusieurs initiatives ont été promues en Afrique, pour un approfondissement historique de son parcours et pour mettre en valeur et discerner l’actualité de son vaste héritage de réflexion.
Mveng était considéré, en effet, non seulement comme un théologien et un historien érudit, mais aussi comme un "ancien", un témoin de la richesse des origines de la culture africaine, mises en valeur par ses études sur la culture égyptienne.
Il était considéré comme "un grand monument", et témoin des contradictions récentes de l’histoire africaine, du drame de la "paupérisation anthropologique".
Ce concept forgé par Mveng voulait signifier une pauvreté bien plus radicale que la pauvreté économique : depuis la traite des Noirs, en passant par la colonisation, la paupérisation anthropologique marquerait l’homme africain, en proie à une crise culturelle profonde de dépersonnalisation, due à la rencontre-choc avec l’Occident. Cette crise, selon Mveng, nous conduisait aussi à nous interroger sur la profondeur de la rencontre de l’Afrique avec le christianisme.
Il ne fut pas seulement un théologien de l’inculturation, mais il maniait aussi "la plume et le pinceau", les études et la peinture. Initiateur de l’Atelier d’arts nègres, il réussit à donner un exemple d’inculturation du symbolisme africain, fruit d’études et de génialité en même temps : son chemin de croix, ses mosaïques et les dessins pour les vêtements liturgiques demeurent un héritage important pour l’Église et un exemple incontournable pour les artistes africains.
A travers l’art, Mveng exprimait sa résistance à l’homogénisation des cultures et la nécessité de confronter l’identité africaine avec la culture occidentale, aujourd’hui de la mondialisation, et d’exprimer tout son dynamisme historique ; pour lui, l’artiste africain d’aujourd’hui doit savoir que l’art est peut-être son unique arme de libération, l’espace par lequel son génie libéré peut dire à Dieu et aux hommes qui il était, qui il est et qui il veut devenir.
« L’art traditionnel africain est l’œuvre de créativité du génie négro-africain ; à travers cette œuvre, l’homme exprime sa vision du monde, sa vision de l’homme et sa conception de Dieu » . L’art se vit et s’exprime dans la musique, la danse, et la poésie. En outre, l’art est un langage cosmologique, anthropologique et liturgique. En tant que langage liturgique l’art est « expression de la célébration cosmique, des mystères divins par l’homme dans sa fonction proprement sacerdotale » . Une meilleure vision de l’art d’Afrique selon Mveng est contenu dans son ouvrage clé, L’art d’Afrique noire. Liturgie cosmique et langage religieux.
Il accordait une grande importance aux études anthropologiques et affirmait qu’il fallait d’abord revaloriser la culture pour envisager des changements significatifs dans les structures sociopolitiques. Comme l’avait déjà soutenu le mouvement de la Négritude.
Enfin, il était également attentif aux problèmes de l’inculturation et à la récupération de l’identité culturelle Africaine, vue comme un "retour de l’exil" de la captivité coloniale.
Bibliographie indicative
Ouvrages
— L’ art et l’artisanat africains, Yaoundé, Clé, 1980.
— Les sources grecques de l’histoire négro-africaine depuis Homère jusqu’à Strabon, Paris, Présence Africaine, 1972.
— Balafons : Poèmes, Yaoundé, Clé, 1972.
— L’Art d’Afrique noire. Liturgie cosmique et langage religieux, Paris Mame, 1964.
— L’Afrique dans l’Église. Paroles d’un croyant, Paris, L’Harmattan, 1985.
— Spiritualité et libération en Afrique, (dir.), Paris, L’Harmattan, 1987.
— Théologie libération et cultures africaines. Dialogue sur l’anthropologie négro-africaine, en collaboration avec Lipawing (B.L.), Yaoundé/ Paris, Clé/ Présence Africaine, 1996.
— The Jerusalem Congress on Black Africa and the Bible, April 24-30 : proceedings/edited by E. Mveng, R.J.Z., Weblosky.
— Colloquium on civilization and Education, Lagos, 17th-31st january, 1977, Editors, A.U. Iwara, E. Mveng.
Articles
— « L’art camerounais », Abbia, n. 3, septembre 1963, p. 3-24.
— « Signification du premier Festival Mondial des Arts Nègres », Abbia n. 12-13, p. 7-11.
— « Les sources de l’histoire du Cameroun », Abbia n. 21, p. 38-42.
— « Archéologie Camerounaise, découverte des Poteries à Mimetala », Bulletin de l’Association Française pour les Recherches et Études Camerounaises, Bordeaux, 1968, tome 3, p. 39-41
— « Les survivances traditionnelles dans les sectes chrétiennes africaines » in Cahiers des Religions Africaines, (7/13), 1973, p. 63-74.
— « Christianity and the religious Culture of Africa » in Kenneth Y. Best (ed.), African challenge, Nairobi, Transafrica Publishers, 1975, p. 1-24.
— « A la recherche d’un nouveau dialogue entre le christianisme, le génie culturel et les religions africaines actuelles » in Présence Africaine, (95), 1975, p. 443-466.
— « De la sous-mission à la succession » in Civilisation noire et Église Catholique, Colloque d’Abidjan, 12-17 septembre 1977, Paris/ Abidjan/Dakar, Présence Africaine/ Les Nouvelles Éditions Africaines, 1978. p. 267-276.
— « Essai d’anthropologie négro-africaine : la personnalité humaine… » in Cahier des religions africaines, (12), 1978, p. 85-96.
— « L’art d’Afrique noire, liturgie cosmique et langage religieux » in Bulletin de Théologie Africaine, (1), 1979, p. 99-103.
— « Christ, Liturgie et culture » in Bulletin de Théologie Africaine, (2/4), 1980, p. 247-255.
« Théologie et langages » in Revue africaine de théologie, (10/20), octobre1986, p. 191-208.
— « Religion, paix et idéologie » in Cahier des Religions africaines, (18/36), juillet 1984, p. 167-177.
— « La théologie africaine de la libération » in Concilium (219), 1988, p. 31-51.
— « Engelbert Mveng : Pauvreté anthropologique et christianisme » in Golias,(36), 1994, p. 149-151.
— « Un concile Africain est-il opportun ? » in Golias (35), 1994, p. 80-87.
— « De la mission à l’inculturation » in Inculturation et conversion. Africains et Européens face au synode des Églises d’Afrique (NDI-OKALA, J., dir.), Paris, Karthala, 1994, p. 11-19.
— « African theology. A methodological approach » in Voices from the third world, (XVIII/1), 1995, p. 106-115.
— « Moïse l’Africain » in Cameroon Tribune, 6 février 1995.
Livres sur E. Mveng
— J.-P. Messina : Engelbert Mveng. La plume et le pinceau. Un message pour l’Afrique du IIIème millénaire (1930-1995), Yaoundé, Presses de l’U.C.A.C., 2003, 191 p.
— F. Lopes : Le radici del pensioro africano : il dialogo tra la filosofia della storia in Engelbert Mveng, Torino, L’Harmattan, 2006
— La communauté des scolastiques jésuites de la Province de l’Afrique Occidentale. Faculté de philosophie St Pierre Canisius Kinshasa, RDC : Père Engelbert Mveng SJ : un pionnier. Recueil d’hommages à l’occasion du dixième anniversaire de sa mort, Kinshasa, Éditions Loyola-Canisius, 2005, 158 p.
Articles sur E. Mveng
— Elenga (Y.C.), « Engelbert Mveng (1930-1995) L’invention d’un discours théologique » in La communauté des scolastiques jésuites de la Province de l’Afrique Occidentale. Faculté de philosophie St Pierre Canisius Kinshasa, RDC, Père Engelbert Mveng SJ : un pionnier. Recueil d’hommages à l’occasion du dixième anniversaire de sa mort, Kinshasa, Éditions Loyola-Canisius, 2005, p. 127-141.
— Hebga (M.P.), « Engelbert Mveng : a pioneer of African Theology » in Bujo (B.), Ilunga Muya (J.) (eds.), African Theology. The Contribution of the Pioneers, Nairobi, Paulines Publication Africa, 2003, p. 39-46.
— Ndi Okala (J.P.), « The Arts of Black Africa and the project of a Christian art », in Missions Studies, Vol. XII-2, 24, 1995, p. 277-284.
— Poucouta (P.), « Engelbert Mveng : une lecture africaine de la Bible » in Nouvelle Revue théologique, (120/1), janv.-mars 1998, p. 32-45.
— Yamb (G.), « L’Afrique d’Engelbert Mveng et de Christophe Munzihirwa » in Telema, (100), octobre-décembre 1999, p. 72-73.
— Yamb (G.), « La christologie africaine de la libération chez Mveng » in La communauté des scolastiques jésuites de la Province de l’Afrique Occidentale. — Faculté de philosophie St Pierre Canisius Kinshasa, RDC, Père Engelbert Mveng SJ : un pionnier. Recueil d’hommages à l’occasion du dixième anniversaire de sa mort, Kinshasa, Éditions Loyola-Canisius, 2005, p. 115-125.